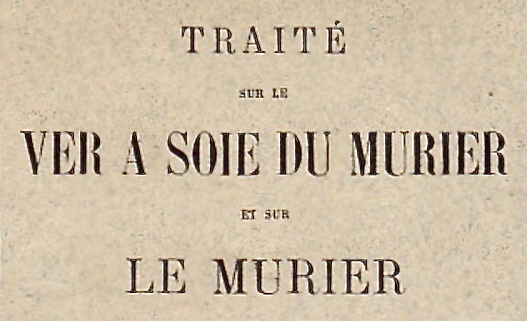La sériciculture est l’élevage du ver à soie qui est lui-même la chenille d’un papillon le « Bombyx Mori ». Elle consiste en l’ensemble des opérations de culture du mûrier, d’élevage du ver à soie pour l’obtention du cocon, de dévidage de cocon, et de filature de la soie. L’élevage s’effectue à partir des œufs du papillon appelés selon l’usage « graines ».
C’est au Xe siècle que les Arabes importèrent au Maroc l’art de cultiver la soie et « enseignèrent aux femmes les moyens de faire éclore la graine en la réchauffant dans leurs seins et laissèrent à leur instinct et à leur habilité le soin d’élever les petites chenilles et filer les cocons » (in rapport de M. Levrat, sur sa mission séricicole au Maroc en 1916).
Mes amis Sy Hassan et Isabelle, de Dar-al-Tiraz (atelier d’artiste, dédié au tissage arabo-andalous manuel : Le Lampas) à Fès et un des très rares ateliers au monde qui produise des étoffes sur métiers à la tire, selon une technique multiséculaire, auxquels j’ai soumis mon texte m’ont fait la remarque suivante, quant à la date d’arrivée de la sériciculture au Maroc ; merci pour ces précisions :
« Je n’ai qu’un point à commenter, à savoir le fait que tu situes l’arrivée de la sériciculture au Maroc au 10ème siècle. Or, à ma connaissance, aucun témoignage historique n’atteste cela (ni ne l’infirme). Et pour cause. Nous n’avons en effet aucun témoignage aussi ancien concernant Fès.
Les sources les plus anciennes relatives à la ville datent du 14ème siècle. Ce sont le Rawd al qirtās, rédigé en 1325 et le Zahrat al ‘ās, texte également rédigé au 14ème (qui reprend quelques données chiffrées d’un inventaire almohade mais rien sur la production de soie). Le premier de ces 2 textes mentionne – au détour d’une description relative aux canalisations d’eau – la présence d’un marché dédié à la soie (le “marché el-hararyn”) dans le cœur de la ville ; le second signale l’existence de magnaneries et d’ateliers dédiés à la cuisson du fil dans Fès, sur les bords du cours d’eau qui la traverse. Quant à Léon l’Africain (qui a vécu à Fès ca. 1492 à ca. 1515), il décrit l’implication d’un grand nombre de Grenadins dans l’industrie de la soie dans la région de Fès. Il explique que la petite bourgade de Camis Metgara, située à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de Fès (bourgade qui n’existe plus aujourd’hui, nous l’avons cherchée en vain !), avait été redynamisée par l’arrivée des exilés andalous, qui y avaient planté de grandes quantités de mûriers blancs (dont le feuillage constitue l’unique nourriture des vers à soie) pour produire la soie et la commercialiser.
Plus largement, avant le 14ème siècle, la sériciculture n’est attestée en Afrique du Nord de façon certaine qu’à Gabès, en Tunisie actuelle, où elle déclina rapidement après avoir été florissante au 10ème siècle (cf. Lombard, Études d’économie médiévale. III. Les textiles dans le monde musulman, pp. 94-95).
Note que l’arrivée du métier à la tire à Fès depuis l’Andalousie date précisément de la fin du 13ème ou du début du 14ème… Il est donc possible que la sériciculture soit arrivée à Fès en même temps que les métiers à la tire (même si ce n’est là qu’une hypothèse).
La sériciculture et l’industrie de la soie furent dans les siècles passés tout à fait prospères dans le Maroc et particulièrement dans la région de Fès. En effet, le mûrier y pousse admirablement et le ver à soie y est généralement favorisé par le climat.
Mais au début du XIXe siècle le commerce de la soie au Maroc fut fortement atteint par la concurrence de la France et de l’Italie qui employaient des procédés bien plus modernes auxquels le Fasi était réfractaire. Puis vinrent, au milieu du XIXe siècle, les ravages de la pébrine, maladie du ver à soie causée par un champignon, et qui, répandue partout, faillit faire sombrer la sériciculture française. Cette dernière ne fut sauvée que par la science de Pasteur qui, en 1865, détermina la cause de la maladie et en fit connaître le remède.
Mais la sériciculture marocaine ne put profiter des découvertes de Pasteur et disparut complètement vers 1870. On trouve cependant encore, dans les années 1920, de vieilles femmes qui avaient autrefois élevé les vers à soie, avaient filé et pratiqué toutes les manipulations que nécessite cette industrie, et des vieux mûriers seuls vestiges de la sériciculture au Maroc.
Le général Lyautey arrive au Maroc, en juin 1912, à la suite de la signature du traité de protectorat et des émeutes de Fès d’avril 1912. Il dira à la réception que lui fit la Chambre de commerce de Lyon le 23 février 1916, l’intérêt qu’il porta de suite à la question de la sériciculture qu’il ressuscite à Fès en 1913 (information rapportée dans la Soierie de Lyon, organe du Syndicat des fabricants de Soie, dans son édition du 16 septembre 1918).
Dès les débuts du Protectorat, un lyonnais, M. Porte apporte des « graines » à Marrakech, les distribue et est ainsi l’initiateur de la rénovation de la sériciculture dans cette région. Le résultat semble nul pour la région de Marrakech qui a été abandonnée à ce point de vue mais à Fès et à Sefrou, quelques particuliers reprennent les élevages de jadis, sous la conduite d’un moniteur de sériciculture envoyé pour tenter de faire revivre l’élevage du ver à soie. Le comte Maurice de Perigny, dans « Au Maroc, Fès, la capitale du Nord » publié en 1916, parle de « la création d’une magnanerie-école à Fès même » :
L’éducation – l’élevage – fut conduite dans un local ouvrant sur un vaste patio, pour ainsi dire à la température libre, où les vers se trouvaient simplement à l’abri du vent et de la pluie. Huit cadres formés chacun de sept tables superposées en claies de roseaux d’une surface de 6 m², constituaient toute l’installation. Malheureusement, la graine expédiée d’Alais subit de longs retards et quantité d’éclosions eurent lieu en cours de route. … On put sauver 200 000 vers.
Malgré ces contretemps et de multiples difficultés (par exemple, en l’absence d’étuve propre à l’étouffage des chrysalides, cette opération fut effectuée dans un simple four de boulanger où il n’était pas facile de remuer les cocons de façon convenable !) l’essai fait en 1914 donna 400 kg de cocons frais, soit un poids unitaire de 2 grammes, supérieur à celui obtenu en France (environ 1,7g).
En 1915, douze marocains qui avaient été fort intéressés par les leçons du moniteur se mettaient à leur tour à l’élevage du ver à soie et malgré de grandes difficultés obtenaient 1349 kg de cocons. À part deux éleveurs qui ont pratiqué leurs éducations sous des paillotes rustiques d’environ 90 m² dans leur jardin à l’extérieur de la ville, les autres éleveurs, tous indigènes, avaient organisé dans leurs maisons disséminées dans les différents quartiers, des installations de fortune inspirées par celle de la magnanerie- école. Il manque toujours un four pour l’étouffage des chrysalides qui s’est pratiqué au soleil : les cocons y sont exposés trois ou quatre jours, mais cette durée prolongée est préjudiciable à la qualité de la soie.
En 1916, le nombre des éleveurs montait à 38, mais une nouvelle épidémie de pébrine ravageait la récolte qui néanmoins, donnait 800 kg de cocons. En 1917, malgré les déboires de l’année précédente le nombre des éleveurs augmentait à 108 et la campagne s’annonçait très bonne quand survint une épidémie de muscardine. La récolte fut de 1150 kg de cocons. En 1918, 41 éleveurs faisaient défection pour des motifs assez vagues et probablement parce que l’intérêt suscité par la tentative de relever une industrie de leurs aïeux n’était pas suffisant. La récolte donnait 1023 kg de cocons caractérisés par leur petitesse.
Les 800 kg de 1916 eurent un emploi des plus intéressants : ils ont servi à alimenter les bassines de filature à la Foire de Fès et une foule de Marocains se pressa pour assister à la transformation des cocons locaux en belles « flottes » de soie.
En effet, la Chambre de commerce de Lyon envoie à la foire de Fès en 1916, un matériel complet de sériciculture, filature, moulinage et tissage de la soie et en plus comme délégué, M. Levrat, le propre chef de laboratoire de la « Condition des soies de Lyon » : il s’agit avant tout de rechercher la trace des éducations de vers à soie que les explorateurs affirmaient exister autrefois au Maroc. À cet effet, ce technicien effectue de nombreuses excursions dans la région et notamment à Sefrou, petite oasis verdoyante au sud de Fès et où règne un air pur, sur les contreforts du Moyen Atlas. Là il trouve quelques vieux marocains qui se souvenaient avoir vu jadis élever des vers à soie et il repère un grand nombre de mûriers centenaires qui avaient certainement alimenté ces bombyx avant que la maladie du ver n’anéantisse cette petite industrie.
Il lui semble que c’est à Sefrou que l’on trouve les conditions les plus favorables pour l’élevage du ver à soie : l’insecte est délicat, il ne faut pas que la graine s’abîme, sans quoi la faculté de naissance s’en ressent ; il y a lieu d’éviter la chaleur pour empêcher une éclosion prématurée devançant la formation des jeunes feuilles du mûrier, en général début avril.
Mûriers à Asaba, au sud de Sefrou. Juin 2008
Séance tenante, il fut décidé que l’on enverrait de Lyon, des éducateurs (éleveurs), des éducatrices (éleveuses) et de la graine des vers à soie pour ressusciter à Sefrou la production séricicole. Mais M. Levrat estime en même temps que concernant le peignage, le décoconnage, la filature, bref la transformation en fil des éléments du cocon il y a encore beaucoup à faire au Maroc. Les procédés actuels sont très rudimentaires. Tout est à créer !
Le cocon marocain pourra être consommé dans le pays même ou bien, étouffé sur place pour être exporté à Marseille. Il estime que l’on ne peut songer encore à installer des filatures à Fès à cause des difficultés matérielles (main-d’œuvre, combustible, transport) et qu’il valait mieux exporter la récolte en France.
Cette exportation présente cependant un inconvénient : si le Maroc vend ses cocons, ce sera en France et il n’en continuera pas moins à acheter ses soies à l’étranger ; en effet, même la soie achetée à Marseille pour le Maroc est de provenance étrangère, la soie française étant d’un prix trop élevé pour les besoins des tisseurs marocains qui n’utilisent qu’une soie assez grossière. Si, au contraire, les cocons sont filés sur place, la soie obtenue sera consommée aussi sur place : la corporation des soyeux aurait donc immédiatement à sa disposition et à meilleur prix la matière première qui lui est nécessaire.
Jos. Vattier, directeur du Bureau économique de Fès, explique que des tentatives de faire revivre la filature avaient été faites lors des premiers essais de sériciculture. Après avoir réussi en 1915 à retrouver deux anciennes fileuses de soie, on leur confia la récolte de 1914. Le dévidage fait selon les procédés et avec les instruments autrefois utilisés donna des fils avec de nombreux défauts : grosseur irrégulière, section rectangulaire et non arrondie, bouchons, baves flottantes etc. Toutes ces défectuosités sont la cause d’un déchet considérable.
On voulut alors perfectionner ce mode de filature et on confia de nouveaux appareils aux deux fileuses. Mais, estimant qu’elles n’avaient rien à apprendre, elles revinrent vite à leurs anciens outils. Il fallut alors recourir à des élèves plus jeunes qui, tant bien que mal, filèrent les récoltes des cocons. Si on veut monter une filature, il faudra auparavant envisager la formation d’apprentis.
En 1919 M. Seignol donne dans la revue France-Maroc les conclusions qui se dégagent de ses quatre campagnes séricicoles (1914 à 1917) à Fès. On retient qu’il n’existe pas à Fès de magnaneries, au sens de locaux édifiés en vue de l’élevage des vers à soie. Les éducations sont faites dans des locaux quelconques : maisons d’habitations, écuries, voir nouallas en roseaux. Ces locaux se prêtent peu à cette activité : l’air s’y renouvelle en général très difficilement et dans tous les cas le chauffage est impossible. Les claies d’élevage sont généralement faites en roseaux assemblés ou refendus et tressés.
Seignol considère que ce n’est que lorsque la sériciculture sera devenue une activité sur laquelle les intéressés compteront au même titre que sur les récoltes courantes, blé ou orge, que de vraies magnaneries, peut-être, s’édifieront.
Il constate que la tentative qui s’annonçait fort bien au début, en 1914, a subi un fléchissement. Si l’on recherche les causes des différents mécomptes au cours de ces campagnes de sériciculture, on trouve notamment pas mal de difficultés provenant des variations de la température dans les locaux insuffisamment appropriés, soit à l’hivernation, soit à l’incubation et l’éclosion : seule une grande entreprise peut avoir des salles construites et aménagées spécialement pour l’élevage.
Mais il y a surtout le manque de formation de la main-d’œuvre locale : la sériciculture demande en effet des spécialistes et il n’y avait à Fès qu’un moniteur qui ne pouvait être à la fois chez tous les éleveurs pour surveiller les soins minutieux et presque continuels qui doivent être donnés aux vers à soie. Des élèves furent formés, au début, ils remplirent leur tâche de leur mieux mais leur naturel nonchalant reprit vite le dessus, empêchant parfois l’exécution immédiate de soins ou de travaux urgents.
Le Fasi pourra-t-il devenir sériciculteur ? telle est la « vraie question » que se pose Seignol : « Or, malgré les expériences faites, malgré mon séjour parmi eux, malgré la tradition des anciens élevages qui, paraît-il, subsistent encore dans le Rif, je ne puis me prononcer, je ne puis répondre à cette question ». « Peut-être faudra -t-il chercher d’autres sériciculteurs que le Fasi ? » si l’on veut que cette industrie naissante ait un avenir bien ensoleillé.
Mais on peut aussi penser que si le Fasi voyait une entreprise réussir sur une grande échelle et donner de beaux bénéfices, il finirait par s’y intéresser et reprendrait réellement l’industrie de ses aïeux en voyant qu’il peut compter sur sa récolte de cocons au même titre et, toutes proportions gardées, que sur ses récoltes courantes de blé ou d’orge. Quelques indications suggèrent un certain optimisme : les premiers essais entre 1914 et 1918 montrent une progression encourageante du nombre des éleveurs locaux : on passe de 12 en 1915 à 108 en 1917 et si les résultats ne sont pas à la hauteur les épidémies de pébrine et de muscardine en sont en partie responsables. Des primes par kilo de cocons récoltés, la gratuité des graines et des feuilles de mûriers ont certainement stimulé des vocations … mais de tout temps des aides financières ont été nécessaires pour développer des activités nouvelles.
L’environnement de Fès, vers 1920, est propice à une relance de la sériciculture : une circonstance très favorable à l’élevage de vers à soie est l’existence à Fès de nombreux mûriers, derniers vestiges de l’ancienne prospérité séricicole. Jos. Vattier, rapporte qu’un recensement fait en 1914 dans les jardins extérieurs de la ville de Fès dénombrait 5 500 mûriers adultes, dont la majorité, de grandes dimensions, produit une quantité considérable de feuilles. La production moyenne d’un mûrier étant de 150 kg de feuilles, la production totale annuelle est de 825 000 kg. Il est donc vraiment regrettable que cette récolte soit purement et simplement perdue.
De plus, il y a encore dans les jardins extérieurs beaucoup de jeunes mûriers et dans les jardins intérieurs une importante quantité de mûriers de tous âges. Ces appoints paraissent susceptibles d’alimenter 1 200 onces de graines de vers à soie jusqu’au troisième âge. Du troisième âge à la fin de l’éducation, ces 1 200 onces trouveraient leur nourriture dans les 825 000 kg ci-dessus indiqués et pourraient produire 65 000 kg de cocons frais. On voit donc le « manque-à-gagner » qu’il y a à laisser sans emploi la production des mûriers. (Un « âge » pour le ver à soie est la période de 5 jours : manger-dormir-muer. Les chenilles muent 4 fois en 1 mois, car elles grandissent vite et leur peau ne peut pas suivre « le mouvement ». La quantité de feuilles fraîches consommée – la chenille n’aime pas les feuilles fanées ! – augmente avec l’âge de la chenille.
Ces arbres favorisés par un climat sans gelées tardives bénéficient en outre des irrigations des jardins pendant la saison sèche. Avec une taille appropriée, on obtiendrait des récoltes excellentes. Enfin la ville a fait planter sur les routes et les chemins environ 15 000 jeunes mûriers, mais leurs feuilles, trop polluées par les poussières, ne peuvent guère servir à l’alimentation des vers à soie.
La région de Sefrou possède aussi un millier de mûriers adultes ce qui permet l’éducation d’environ 150 onces de graines pouvant donner une récolte de 8 000 à 9 000 kg de cocons frais. Comme à Fès le terrain et le climat se prêtent fort bien à la culture du mûrier et à l’élevage du ver à soie.

Cueillette des mûres, à Asaba, au sud de Sefrou. Juin 2008
Pour réussir l’implantation de la sériciculture, dans cet environnement naturel favorable, d’autres facteurs de réussite sont nécessaires. Jos. Vattier les évoque dans Le Monde Nouveau, juin 1921 :
– Comme il est indispensable de rester maître absolu de l’incubation et de l’éclosion des graines, pour avoir des jeunes vers d’un âge régulier, il faut avoir d’abord une salle d’hivernage de température toujours inférieure à 6°C, de décembre au 15 mars. Ce local ne pourra se trouver qu’en se rapprochant des montagnes (au poste d’Annoceur par exemple, situé au sud de Sefrou, à 1200 m d’altitude, où on a déjà placé des graines). Cet hivernage est nécessaire, car l’expérience a prouvé que les graines partant de France en février subissaient en route une telle température que beaucoup de jeunes vers étaient éclos à l’arrivée. L’importation des graines en automne, au contraire, ne présente aucune difficulté.
– Il faut ensuite posséder une salle d’incubation avec couveuse de façon que l’incubation soit normale et puisse être menée de manière à provoquer les éclosions au début d’avril époque de la poussée des jeunes feuilles de mûrier.
– Des magnaneries sont aussi à construire, car les locaux existants à Fès ne se prêtent que bien peu à l’élevage de vers à soie.
– Enfin quoique l’on puisse étouffer la récolte au soleil, le moyen le plus rationnel consiste à avoir un four à étouffer ce qui évite la perte par papillonnage.
– Pour éviter et prévenir les épidémies une entreprise bien montée devrait avoir un laboratoire qui étudierait les diverses maladies qui pourraient surgir. De plus, ce laboratoire s’occuperait utilement en élevant chaque année différentes races de vers en recherchant celle qui convient le mieux au Maroc et en faisant de la reproduction pour les salles d’élevage et en vérifiant les graines importées.
– Il faut former une main-d’œuvre locale qualifiée et encadrée pour qu’elle ne néglige pas certains soins, dont l’absence peut avoir des conséquences désastreuses pour la récolte.
La réalisation de ces objectifs favorisera le développement et/ou la relance de l’industrie textile de la soie à Fès. Car même si l’élevage des vers à soie avait pratiquement disparu à Fès après 1870, l’industrie de la soie persiste : vers 1915, il existe à Fès environ 25 métiers à mouliner, 420 métiers à tisser et toute cette industrie, moulinage, lavage, teinture, dévidage et tissage n’occupe pas moins de 10 000 personnes, hommes et femmes. Il y a environ 150 patrons possesseurs de deux à six métiers à chacun desquels sont employés deux ouvriers sans compter les différents apprentis occupés au dévidage et à l’ourdissage (chiffres cités par de Périgny). Tous ces tisserands de soie, harrâra, ne fabriquent que des tissus pour femmes, ceintures et foulards et des rideaux ou tentures destinés à décorer les appartements pour les mariages.

Détail ceintures de soie. Planche 40 dans « Soieries marocaines. Les ceintures de Fès » Lucien Vogel. Vers 1920, ouvrage non daté.
Jos.Vattier dans l’article du Monde nouveau, passe en revue les différentes branches de cette industrie : le dévidage des cocons ou filature, le moulinage, le lavage et la teinture, le tissage.
Filature : l’industrie du dévidage suivit, au Maroc, le sort de la sériciculture et sombra faute de cocons à filer. Si de nouveau on parvient à réussir l’élevage du ver à soie, il y a donc lieu de se demander ce qu’il faudra faire de la récolte : doit-elle être dévidée sur place ou doit-on l’expédier en France aux fins de filature ? (voir plus haut).
Moulinage. Les métiers à mouliner employés localement sont très curieux et assez ingénieux, mais il y aurait lieu de les perfectionner. En effet le mouvement avec lequel on obtient la rotation des fuseaux est un mouvement à friction et périodique, avec transmission très défectueuse ; il en résulte une vitesse de rotation des fuseaux très variable et non réglable.
Le personnel semble très habile et obtiendrait certainement de bons résultats avec des appareils du même modèle perfectionné.
Lavage et teinture. Les procédés de lavage (ou décreusage) et surtout la teinture demanderaient une étude minutieuse pour en déterminer la valeur ; à première vue, ils semblent donner de très bons résultats.
Le tissage. La question des perfectionnements à apporter aux métiers à tisser est assez délicate. En effet, malgré leur rusticité, ils satisfont à tous les besoins actuels du commerce local qui, peut-être même, s’accommoderait mal de tissus plus fins. Le reproche le plus fondé que l’on puisse faire à ces métiers, c’est de produire peu relativement au personnel employé.
Soulignons, en terminant, l’importance de la consommation fasie en soie, notre marché local ayant importé de l’extérieur 77 430 kg de soie grège en 1916, 61 690 kg en 1917, 115 881 kg en 1918, et 353 574 kg en 1919.
On peut dire à l’examen de ces différents éléments qu’une première tentative de relever la sériciculture dans la région de Fès, faite par l’administration sur une petite échelle, avec peu de moyens, sans main-d’œuvre professionnelle et sans locaux appropriés a démontré que faire revivre l’industrie séricicole du Maroc était possible. Peut-on en déduire qu’une entreprise qui, après une étude approfondie faite sur place, monterait en grand son industrie, en construisant les bâtiments nécessaires et en ayant, après formation, un personnel idoine, assez nombreux, pour répondre aux exigences de toutes les étapes, depuis la culture du mûrier jusqu’à la filature de la soie, pourrait réussir ?
Je n’ai pas trouvé de publications faisant état d’un développement industriel de la sériciculture à Fès et dans sa région, dans les années suivantes. Par contre les mûriers plantés en 1923/24 en ville nouvelle de Fès furent progressivement arrachés et remplacés par des platanes dans les années 1930, signe peut-être que l’industrie séricicole n’était pas très florissante, même si ces feuilles de mûriers de centre ville polluées par les poussières n’étaient pas une nourriture ce choix pour les vers à soie.
Des petits élevages ont subsisté et pendant la guerre (1939-1945) l’administration du Protectorat à Rabat avait demandé aux écoles musulmanes d’élever des vers à soie pour procurer aux hôpitaux des crins de Florence dont les services de chirurgie avaient bien besoin. La section agricole de l’école professionnelle de Sefrou a eu une classe transformée en magnanerie, les claies étaient fournies par l’atelier de menuiserie de l’école ; les élèves allaient ramasser les feuilles de mûriers, en garnissaient les claies, nettoyaient, surveillaient la croissance. Quand les vers cherchaient à monter, on les noyait dans un bassin de bois rempli d’eau vinaigrée ; ensuite chaque ver est ouvert en deux : apparait une glande jaune vif ; prise par les deux bouts, étirée sur 50 cm, accrochée à un fil où elle sèche : c’est le crin de Florence.
Il est aussi fait mention dans le Courrier du Maroc, quotidien de Fès, le 6 mai 1941, d’une « magnanerie dans l’immeuble de l’Urbaine et la Seine, dans l’ancien immeuble du P.S.F. » Cet immeuble étant situé en plein centre ville de Fès, la magnanerie était certainement une exploitation artisanale. Il est précisé qu’elle occupe des femmes et enfants de la société de Bienfaisance. Les cocons sont vendus à Lyon. Il est également fait mention d’une autre magnanerie à Montfleury (zone agricole .. à l’époque, à 5 ou 6 km du centre ville) montée par M. Jodlon, qui produit des cocons pour la soie naturelle, et du crin de Florence, pour la chirurgie et le fil de pêche.
Ce recours à des petites structures, à des classes des écoles musulmanes ou à des associations de bienfaisance me semble confirmer qu’il n’existait pas à l’époque d’industrie séricicole à Fès.
Enfin j’ai trouvé une étude de 1962, faite par la SATEC et intitulée « Études des possibilités d’implantation de la sériciculture au Maroc » ; pour réaliser cette étude la SATEC, en avril 1962, a entrepris un élevage expérimental, dont une des principales difficultés a été l’approvisionnement en feuilles de mûriers ! Une information supplémentaire qui me fait dire qu’il n’y a pas eu de développement industriel de la sériciculture au Maroc après les expériences à petite échelle des années 20.
Je terminerai par un petit paragraphe sur le Crin de Florence
C’est un fil obtenu en étirant l’appareil séricigène du ver à soie, chenille du « Bombyx Mori », après l’avoir tuée en la trempant dans du vinaigre. Connu des Chinois depuis la plus haute antiquité, ce « fil » a d’abord été utilisé pour la confection de cordes pour des instruments de musique, puis a servi surtout et sert toujours de bout de ligne de pêche sur lequel est fixé l’hameçon. Son utilisation en chirurgie date du début du XIXe siècle : d’abord utilisé par des chirurgiens-dentistes, puis par des chirurgiens britanniques et allemands, il fut ensuite considéré en France par le Dr Lucas-Championnière(1843-1913) comme un excellent moyen de suture.
Marie Rouanet, a écrit Le Crin de Florence et autres textes, en 1997, aux éditions Climats. Le texte sur le crin de Florence était un sujet de l’épreuve de Français du Brevet des Collèges en 2001 :
À l’épouvantable odeur de pourriture qui imprégnait leurs vêtements, leurs mains et leurs cheveux, on reconnaissait les fillettes travaillant à la soie.
Dans la chaleur d’étuve des filatures, leur visage écarlate penché sur les bassinets d’eau bouillante, elles allaient chercher de leurs mains agiles, mais enflées et rouges comme celles des laveuses de lessive, l’extrémité du fil de soie.
Les fileuses avaient dix, onze, douze ans, souvent moins. On les faisait mettre en rang, on leur faisait croiser les bras et réciter la prière. Ce n’était pas pour rien qu’on nommait les filatures les « couvents soyeux ».
Tout au long du jour de travail, un long jour de douze heures – il commençait quand il faisait encore nuit et s’achevait à la nuit : 5 h, 19 h, la vapeur d’eau et la chaleur exaltaient l’odeur des chrysalides mortes.
Et c’est dans la puanteur et l’inconfort de l’humidité brûlante, que grossissaient au-dessus de leurs têtes les écheveaux de claire soie.
Ainsi la soie somptueuse naissait-elle dans l’odeur de la mort. Mais il y avait un travail plus déplaisant, plus malodorant encore que celui du dévidage des cocons.
Certains vers étaient ouverts vivants. Les doigts menus allaient chercher, dans la tiédeur visqueuse des viscères, les glandes séricigènes. Il fallait les étirer mécaniquement pour obtenir un fil plus fin qu’un cheveu et plus solide qu’un filin.
On en fabriquait des bas de lignes et un fil chirurgical pour les sutures les plus délicates.
On l’appelait : le crin de Florence.

Détail ceintures de soie. Planche 41 dans « Soieries marocaines. Les ceintures de Fès » Lucien Vogel

Détail ceintures de soie. Planche 49 dans « Soieries marocaines. Les ceintures de Fès »
Sur les soieries et ceintures voir Les ceintures de Fès
Lien vers Dar-al-tiraz : https://www.dar-al-tiraz.com/